Sur les 90 éléments naturels que renferme notre planète, 12 seulement étaient isolés et identifiés à la fin du XVIIe siècle. Au cours des siècles suivants, le plus grand nombre d’éléments découverts ou isolés reviennent aux Français (20 éléments), devant les Allemands et les Anglais (17 éléments) puis les Suédois (16 éléments). Diverses nationalités se partagent la dizaine d’autres. Parmi les éléments découverts par les Français, l’iode qui occupe la case 53 sur la classification des éléments. Il a été découvert en 1811 par le chimiste Bernard Courtois (1777-1838). Fils du chimiste Jean-Baptiste Courtois (1748-?), il est l’un des premiers élèves de l’École Polytechnique (1898). Revenu à la vie civile après avoir été incorporé dans le service de Santé des Armées, il découvre la morphine en 1801, en l’extrayant de l’opium. Son père avait été l’un des premiers à créer une salpêtrière artificielle, c’est-à-dire un lieu de production de salpêtre.…
Rigueur et observation sont les deux qualités primordiales du chercheur. L’interprétation des résultats observés vient plus tard. Les exemples sont nombreux dans l’histoire de la recherche où la curiosité liée à l’observation a conduit à des découvertes importantes. Comme cela a été décrit dans un précédent billet, Henri Becquerel découvre, en février 1896, les rayons uraniques, émis par des sels d’uranium. Marie Curie décide de s’intéresser à cette émission de rayonnements comme sujet pour le doctorat qu’elle entreprend. C’est un raisonnement de chimiste qui conduit Marie Curie à découvrir que ce phénomène est beaucoup plus général. En effet, que fait un chimiste qui veut étudier un phénomène qui touche un minerai d’uranium ? Il le purifie, pensant amplifier cet effet. Or, l’émission de radiations qu’elle obtient est, au contraire, plus faible ! Cette constatation la conduit à penser que la « gangue » du minerai contient des éléments plus «…
Lorsque la nouvelle de la découverte des rayons X par Wilhelm Röntgen arrive à Paris, fin 1895, Henri Becquerel (1852-1908) étudie depuis plusieurs années, dans son laboratoire du Muséum national d’histoire naturelle, les phénomènes de phosphorescence. Il se demande alors si les rayons X entrent en jeu. Au cours de la dernière semaine de février 1896, il entreprend une série d’expériences sur des sels d’uranium, qu’il expose à la lumière du soleil. Ses plaques photographiques sont effectivement impressionnées. Le responsable : un rayonnement émis par les sels d’uranium. Il observe ensuite si ce rayonnement plus ou moins absorbé par un écran métallique, une petite croix de Malte en cuivreinterposée entre les sels d’uranium et la plaque. Hélas, le soleil se montre très peu cejour-là, le mercredi 26 février, et encore moins les jours suivants, ni même le dimanche 1er mars, veille du jour où se tient la séance de l’Académie…
Le fer, le nickel, l’oxygène, l’arsenic ou le chrome sont des éléments chimiques (il y en a 90 naturels et 28 artificiels). Dans la classification des éléments, ils occupent les cases notées de 1 à 118. Après 1925 et la découverte par l’allemande Ida Noddack du rhénium (appelé ainsi en hommage au fleuve Rhin, case 75), il ne restait plus que deux éléments naturels, et radioactifs, à découvrir aux cases 85 et Marguerite Perey (1909-1975) va découvrir l’un d’entre eux. Depuis longtemps, la « chasse » à l’élément 87 était ouverte. Plusieurs savants russes (en 1926), anglais (1928-1930) et français (1936) pensent l’avoir découvert mais, à chaque fois, leur découverte sera infirmée à juste titre. Ces diverses découvertes avaient donné lieu à chaque fois à des nouveaux noms (russium, alkalinium, virginium, moldavium) qui finiront donc aux oubliettes. Marguerite Perey travaillait alors à Paris, à l’Institut du radium fondé par Marie…
Vert, bleu ou blanc, on attribue des couleurs à l’hydrogène, présenté comme une piste prometteuse dans le secteur de l’énergie. Plus ou moins propre, chaque couleur définit un mode de production. L’hydrogène, tel qu’on l’entend ici, est la molécule composée de deux atomes éponymes, H2. Or, si l'hydrogène est présent dans l'univers – et c'est même la molécule qui y est la plus commune – il n'existe qu'en très faible quantité (de l'ordre de 0,5 ppm) dans l’atmosphère terrestre. Les ressources principales permettant de produire le dihydrogène H2 (que l'on appelle hydrogène par abus de langage) sont l'eau et les hydrocarbures (le charbon, le pétrole ou le gaz). La production actuelle d'hydrogène est dans la plupart des cas réalisée à partir de gaz naturel via un processus appelé "vaporeformage" qui consiste à séparer des molécules d’hydrogène de celles de carbone auxquelles elles sont reliées grâce à de la vapeur d’eau…
En 1819, le jeune bachelier Antoine-Jérôme Balard (1802-1876) entre comme élève chez deux pharmaciens à Montpellier.En parallèle de ses étude set de son activité dans la pharmacie, il travaille à la Faculté des Sciences de cette ville comme préparateur de chimie. Alors qu’il étudie une variété d’algues brunes tirée des préssalés de Montpellier, il en tire une substance qu’il suppose, dans un premier temps, être un composé d’iode ou de chlore mais une analyse plus poussée lui permit de montrer qu’il s’agissait d’un nouvel élément. Balard a 24 ans quand il fait cette annonce Il annonce sa découverte en 1826. Toutefois, il avait déposé le 7 novembre 1825 un pli cacheté qui ne sera ouvert que 100 ans plus tard, le 12 juillet 1925 par un éminent chimiste de l’époque, Henry Le Chatelier (1850-1936), et qui annonçait déjà cette découverte. Balard propose le nom de « muride », dérivant du…
![Lire la suite à propos de l’article [La Physique attoseconde récompensée par le Prix Nobel de physique 2023]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2023/11/attoseconde.jpg)
Une attoseconde, c’est un milliardième de milliardième de seconde, et il y en a plus dans une seconde que de secondes qui ne se soient écoulées depuis la création de l’Univers… Ces ordres de grandeur vertigineux disent la complexité du champ de recherches d’Anne L’Huillier, Ferenc Krausz et Pierre Agostini, qui leur a permis de devenir lauréats du prix Nobel de physique 2023. L'étude des phénomènes ultra-rapides a toujours été au cœur de la recherche en physique. Dans ce domaine, l'une des découvertes les plus révolutionnaires des dernières décennies a été la manipulation d'attosecondes. Une attoseconde équivaut à une quintillionième de seconde, soit 10-18 secondes. Ces durées extrêmement courtes permettent aux physiciens de sonder et de comprendre des processus fondamentaux à l'échelle atomique et subatomique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la recherche en physique et en chimie notamment. La génération d'attosecondes est un exploit technologique remarquable. Elle repose sur…
L'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) est l’expert public en matière de recherche et d’expertise sur les risques nucléaires et radiologiques. Il est au service des pouvoirs publics et de la population. La singularité de l’lnstitut réside dans sa capacité à associer chercheurs et experts pour anticiper les questions à venir sur l’évolution et la maîtrise des risques nucléaires et radiologiques. Les femmes et les hommes de l’IRSN ont à cœur de faire connaître leurs travaux et de partager leurs savoirs avec la société. Ils contribuent ainsi à améliorer l’accès à l’information et le dialogue avec les parties prenantes. L’Institut concourt aux politiques publiques de sûreté et sécurité nucléaires, de santé, d’environnement et de gestion de crise. Rattaché à la Direction de l’Environnement de l’IRSN, au sein du pôle "Santé et Environnement", le Laboratoire de radioécologie de Cherbourg-Octeville (LRC) a pour principale thématique de recherche l’étude des processus…
![Lire la suite à propos de l’article [De la préparation de matériaux avancés à l’étude de leur fonctionnement à l’échelle moléculaire]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2023/10/nanoreve.jpg)
Le Laboratoire Catalyse et Spectrochimie (LCS) prépare et étudie des catalyseurs solides pour les applications dans le domaine de l’environnement et du développement durable. Le LCS est une unité mixte de recherche (UMR 6506) du CNRS, de l’École Nationale Supérieure des Ingénieurs de Caen (ENSICAEN) et de l’Université de Caen Normandie. Avec un pôle très fort en spectroscopie infrarouge, mais aussi en résonance magnétique nucléaire et en spectroscopie Raman, le LCS occupe une place unique dans le domaine de la dépollution automobile (catalyseurs d’échappement), dans la production d’énergie (raffinage, biocarburants) et dans le domaine des bioressources. Ses deux principaux axes de recherche portent sur les zéolithes – aluminosilicates cristallins d'intérêt pour la fabrication de catalyseurs grâce à leurs propriétés physiques et chimiques et en particulier leur réseau microporeux organisé et régulier, à l'intérieur duquel se déroule une partie des réactions catalytiques – d’une part, les spectroscopies in situ et operando –…
Le Laboratoire de Physique des Plasmas (LPP) de Paris mène un projet associant des technologies plasma afin de produire du méthane à partir de dioxyde de carbone de façon la plus décarbonée possible. Un prototype démontrant l'efficacité du procédé est en conception. La transition énergétique est un enjeu majeur de la lutte contre le réchauffement climatique, dont les clés reposent sur le développement des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la sobriété, le stockage du dioxyde de carbone (CO2) ou encore le recyclage d'une partie du CO2 émis par les activités humaines. Dans la suite de ses travaux de thèse, la Société d'accélération de transfert technologique (SATT) de Paris-Saclay vient d’accorder à Edmond Baratte un financement visant à améliorer un prototype permettant la conversion d'un mélange de CO2 et de dihydrogène (H2) en méthane (CH4). Cette dernière molécule est celle du gaz naturel, très utilisé pour le chauffage par exemple. Ce processus…
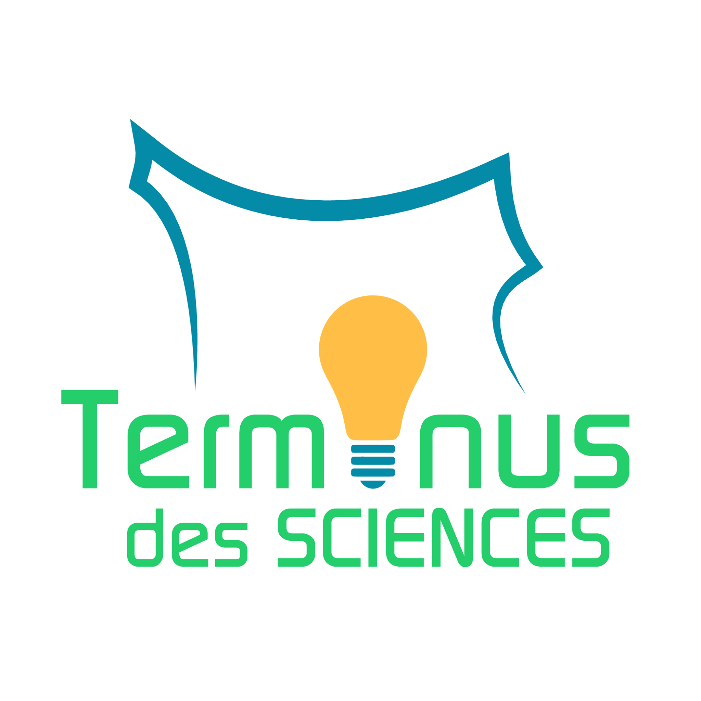
![Lire la suite à propos de l’article [C’est à Cherbourg que de l’iode a été produit pour la première fois]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2024/06/algue_iode.jpg)
![Lire la suite à propos de l’article [La « vérité » en science : Marie Curie et le piège du potassium-40]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2024/05/curie.jpg)
![Lire la suite à propos de l’article [Comment l’absence de soleil a bouleversé le monde]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2024/04/becquerel.png)
![Lire la suite à propos de l’article [On doit la découverte du francium… à une Française]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2024/01/perey.jpg)
![Lire la suite à propos de l’article [Les couleurs de l’hydrogène]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2024/01/couleurs_hydrogene.jpg)
![Lire la suite à propos de l’article [La découverte du brome… qui aurait dû s’appeler muride]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2023/11/brome.jpg)
![Lire la suite à propos de l’article [La Physique attoseconde récompensée par le Prix Nobel de physique 2023]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2023/11/attoseconde.jpg)
![Lire la suite à propos de l’article [Le Laboratoire de Radioécologie de l’IRSN]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2023/10/irsn.jpg)
![Lire la suite à propos de l’article [De la préparation de matériaux avancés à l’étude de leur fonctionnement à l’échelle moléculaire]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2023/10/nanoreve.jpg)
![Lire la suite à propos de l’article [Recycler le CO2 en méthane]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2023/04/methane.jpg)