![Lire la suite à propos de l’article [L’impact des politiques américaines sur la recherche climatique]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2026/01/science_us.jpg)
Depuis plusieurs décennies, les États-Unis jouent un rôle déterminant dans le développement de la recherche climatique mondiale. L’impact des politiques américaines dans ce domaine est fort, qu’il s’agisse de financements, de données scientifiques ou d’architectes d’infrastructures de modélisation. Le premier levier est celui du financement fédéral, qui soutient la majorité des travaux de recherche fondamentale et appliquée sur le climat aux États-Unis. Des agences comme la NASA, la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), la NSF (National Science Foundation) ou le Department of Energy (DOE) disposent de budgets dédiés à la surveillance des systèmes climatiques, au développement des modèles prédictifs, et à l’analyse des données issues des satellites, bouées océaniques et autres réseaux d’observation. Or, ces financements dépendent largement des priorités fixées par les administrations présidentielles et le Congrès quant aux orientations de recherche. L’alternance entre administrations républicaines et démocrates illustre bien ce phénomène. Sous la présidence de George W.…
Averse, déluge, giboulée, grain, ondée, précipitation… La pluie et la neige sont issues d’un même processus fondamental : la condensation de la vapeur d’eau contenue dans l’atmosphère. Mais leur formation, leur apparence et leur perception au sol varient en fonction de nombreux facteurs physiques, notamment la température, la structure des nuages, ou encore la dynamique de l’air. Tout commence par l’évaporation de l’eau à la surface de la Terre — océans, lacs, sols humides — qui enrichit l’air en vapeur d’eau. Cette vapeur invisible s’élève avec l’air chaud et humide, qui, en montant dans l’atmosphère, rencontre des couches plus froides. C’est là que la condensation se produit : la vapeur d’eau se transforme en minuscules gouttelettes d’eau ou en cristaux de glace autour de "noyaux de condensation" — souvent des poussières ou des pollens — pour former les nuages. Lorsqu’elles deviennent assez grosses, elles tombent sous l’effet de la gravité.…
![Lire la suite à propos de l’article [Les accords de Paris ont 10 ans]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2026/01/accords_paris.jpg)
L’objectif des accords de Paris (COP21, 12 décembre 2015) était simple dans sa formulation, mais extrêmement ambitieux : mobiliser l’ensemble des États pour limiter le réchauffement climatique bien en‑dessous de 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle, et autant que possible à 1,5 °C, tout en adaptant les sociétés aux impacts croissants du changement climatique. Sur la décennie, plusieurs avancées structurantes peuvent être soulignées. L’accord a d’abord fonctionné comme un cadre multilatéral de référence qui a résisté à des contextes géopolitiques et économiques difficiles, y compris la pandémie de Covid‑19, sans qu’un grand État ne se désengage de façon durable (même si les États‑Unis ont connu deux périodes de retrait politique récent, sous la présidence de Donald Tromp). L’une des transformations les plus significatives a été l’adoption généralisée de contributions déterminées au niveau national (CDN), ces engagements volontaires de réduction des émissions et d’adaptation que chaque pays doit réviser tous les cinq ans. Cette logique…
À première vue, les dunes ne semblent être que des collines de sable modelées par le vent. Pourtant, ces paysages façonnés à l’interface entre la mer et la terre sont bien plus que de simples formations géologiques. Ils constituent de véritables écosystèmes dynamiques, complexes et résilients, capables d’évoluer, de s’autoréguler et de jouer un rôle écologique essentiel dans les zones littorales. C’est dans cette perspective qu’on peut les qualifier d’« intelligents », non pas au sens cognitif du terme, mais parce qu’ils fonctionnent comme des systèmes adaptatifs en constante interaction avec leur environnement. Le sable, élément central de ces milieux, n’est jamais immobile. Il circule, se déplace au gré des vents, se dépose puis repart, en fonction de la météo, des marées, de la végétation ou encore des aménagements humains. Cette mobilité constitue l’essence même du massif dunaire. Si ce mouvement venait à être entravé, c’est toute la vitalité du…
![Lire la suite à propos de l’article [Le label Géoparc mondial de l’UNESCO et le cas de La Hague]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2025/11/geoparc.jpg)
Le label « Géoparc mondial de l’UNESCO » désigne des territoires dont le patrimoine géologique est jugé remarquable à l’échelle internationale ou régionale. Ce label, encore peu connu du grand public, vise à faire dialoguer géologie, environnement, culture et développement durable au sein d’un même projet de territoire. Il implique une dynamique collective où l’éducation, la valorisation touristique et la participation locale jouent un rôle central. Un Géoparc n’est pas une réserve naturelle figée : c’est un espace habité, vivant, qui s’appuie sur la richesse de ses paysages et de ses roches pour construire un récit accessible à tous. Le label implique donc une gouvernance active, des actions d’animation, des supports pédagogiques, des événements et souvent un engagement fort des collectivités et des habitants. Le territoire doit également s’inscrire dans un réseau international de coopération, partageant ses expériences avec d’autres Géoparcs à travers le monde. Dans ce contexte, le projet…
![Lire la suite à propos de l’article [Neurocorticoïdes, agriculture et biodiversité : comprendre les enjeux de la loi Duplomb]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2025/08/betteraves.jpg)
La récente loi Duplomb, adoptée en juillet 2025, a ravivé les tensions autour de l’usage de certains pesticides en agriculture, en particulier ceux que l’on regroupe sous le nom de neurocorticoïdes. Ce terme fait référence à des insecticides neuroactifs, proches des néonicotinoïdes, longtemps utilisés pour protéger les cultures des insectes ravageurs. Leur efficacité est indéniable : en agissant sur le système nerveux des insectes, ils provoquent leur paralysie et leur mort. Pourtant, ces substances ont aussi un revers préoccupant, car elles affectent bien plus que les seuls nuisibles visés. Le cœur du problème réside dans leur mode d’action et leur persistance. Les neurocorticoïdes, une fois appliqués, sont absorbés par la plante et se retrouvent dans toutes ses parties : feuilles, tiges, fleurs, mais aussi nectar et pollen. Cette propriété les rend redoutablement efficaces, mais elle expose aussi tous les insectes qui interagissent avec la plante, y compris les pollinisateurs comme les abeilles.…
Alors que les canicules deviennent de plus en plus fréquentes et plus intenses en France, certaines zones comme Cherbourg semblent échapper à ce fléau. La ville normande attire déjà des visiteurs en quête de fraîcheur. Mais ce potentiel paradis climatique est-il durable ? Face aux projections climatiques alarmantes, Cherbourg pourrait-elle devenir un véritable refuge climatique ou perdre cet avantage ? Une canicule est une période prolongée de chaleur intense, caractérisée par des températures élevées de jour comme de nuit. Ce manque de fraîcheur nocturne empêche le corps de se régénérer, ce qui augmente les risques sanitaires, en particulier pour les personnes vulnérables. En France, les épisodes caniculaires se multiplient et s’intensifient. Entre fin juin et début juillet, le pays a connu une vague de chaleur exceptionnelle, avec des températures dépassant les 40 °C. Ce phénomène, autrefois rare, devient de plus en plus fréquent avec le dérèglement climatique. Les impacts sont déjà…
Les tiques, ces petits acariens parasites, sont bien connues pour leur rôle dans la transmission de maladies infectieuses comme la maladie de Lyme. Une récente étude publiée dans Frontiers in Cellular and Infection Microbiology révèle que le réchauffement climatique favorise leur prolifération et leur dispersion à travers le monde. Ces changements posent un risque croissant pour la santé humaine et animale, nécessitant une vigilance accrue et des stratégies de prévention adaptées. Les tiques sont des parasites externes, de la même famille que les araignées, qui se nourrissent du sang des mammifères, des oiseaux et parfois des reptiles. Lorsqu’une tique mord un hôte pour se nourrir, elle peut transmettre des agents pathogènes responsables de maladies potentiellement graves. La maladie de Lyme est l’une des infections les plus courantes transmises par les tiques en Europe et en Amérique du Nord. Elle est causée par la bactérie Borrelia burgdorferi et peut entraîner des…
Le Vendée Globe, souvent surnommé « l’Everest des mers », est une course à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. Cette épreuve mythique, qui traverse les océans de la planète, met à rude épreuve les skippers et leurs bateaux, confrontés à des conditions météorologiques et marines extrêmes. Comprendre ces défis aide à saisir l'exploit accompli par ces navigateurs hors pair. Le Vendée Globe débute et se termine aux Sables-d'Olonne, en Vendée, en passant par les trois grands caps : le Cap de Bonne-Espérance (Afrique du Sud), le Cap Leeuwin (Australie) et le Cap Horn (Amérique du Sud). Ce tracé couvre plus de 40 000 km, majoritairement dans les mers australes, où se concentrent les vents les plus puissants et les vagues les plus hautes du globe. Les skippers doivent composer avec des climats variés selon les régions traversées, Ainsi, si les alizés tropicaux, des vents réguliers de l’Atlantique…
![Lire la suite à propos de l’article [Cyclones et réchauffement climatique : comprendre les mécanismes derrière les tempêtes]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2024/12/cyclone.jpg)
Les récentes intempéries qui ont frappé Mayotte rappellent à quel point les cyclones peuvent être destructeurs. Comment ces phénomènes naturels se forment-ils et dans quelle mesure le réchauffement climatique influence-t-il leur intensité ? Les cyclones, aussi appelés ouragans ou typhons selon les régions du monde, sont des tempêtes tropicales de grande envergure. Ils se forment au-dessus des océans tropicaux chauds, où la température de l’eau dépasse généralement 26°C sur une profondeur d’au moins 50 mètres. Cette chaleur océanique est la source d’énergie qui alimente ces gigantesques systèmes météorologiques. Le processus de formation d’un cyclone, appelé cyclogenèse, suit plusieurs étapes clés : Évaporation et ascension : Lorsque la surface de l’océan est chaude, l’eau s’évapore et monte dans l’atmosphère sous forme d’air chaud et humide. Refroidissement et condensation : À mesure que l’air s’élève, il se refroidit, provoquant la condensation de la vapeur d’eau en gouttelettes. Ce phénomène libère de la…
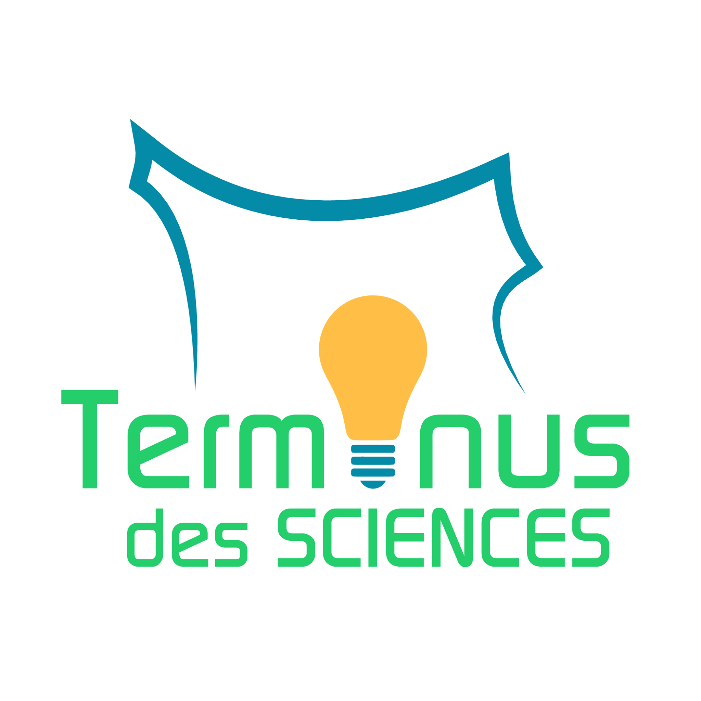
![Lire la suite à propos de l’article [L’impact des politiques américaines sur la recherche climatique]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2026/01/science_us.jpg)
![Lire la suite à propos de l’article [Y r’pleut !]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2026/01/pluie.jpg)
![Lire la suite à propos de l’article [Les accords de Paris ont 10 ans]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2026/01/accords_paris.jpg)
![Lire la suite à propos de l’article [Les massifs dunaires : un écosystème intelligent]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2025/11/dunes.jpg)
![Lire la suite à propos de l’article [Le label Géoparc mondial de l’UNESCO et le cas de La Hague]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2025/11/geoparc.jpg)
![Lire la suite à propos de l’article [Neurocorticoïdes, agriculture et biodiversité : comprendre les enjeux de la loi Duplomb]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2025/08/betteraves.jpg)
![Lire la suite à propos de l’article [Le Cotentin, un refuge climatique ?]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2025/08/climat_normand.jpg)
![Lire la suite à propos de l’article [Les tiques et le réchauffement climatique : une menace grandissante]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2025/04/tique.jpg)
![Lire la suite à propos de l’article [Vendée Globe, course humaine et naturelle]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2025/02/vendee_globe.jpg)
![Lire la suite à propos de l’article [Cyclones et réchauffement climatique : comprendre les mécanismes derrière les tempêtes]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2024/12/cyclone.jpg)