Le 5 août 2025, la Terre a connu une rotation légèrement plus rapide que d’habitude. Ce jour-là, la durée exacte d’un tour complet a été inférieure d’environ 1,3 milliseconde à la norme des 86 400 secondes, soit 24 heures. Ce phénomène, imperceptible à l’échelle humaine, a cependant été suffisamment notable pour que les scientifiques le considèrent comme la journée la plus courte jamais enregistrée.
Ce n’est pas un événement isolé : l’été 2025 a vu plusieurs journées de ce type, notamment les 9 et 22 juillet. Ce que ces journées ont en commun, c’est qu’elles marquent une accélération temporaire de la rotation de la Terre. Cela peut surprendre, car on sait que la rotation terrestre ralentit lentement au fil des siècles à cause des effets gravitationnels de la Lune. Pourtant, depuis les années 2020, on observe une tendance inverse : des accélérations ponctuelles, parfois brusques.
Plusieurs phénomènes peuvent expliquer de telles fluctuations. L’atmosphère, les océans, les calottes glaciaires et même les grands séismes participent tous à redistribuer la masse terrestre. Cette redistribution modifie légèrement le moment d’inertie de la planète, et donc sa vitesse de rotation. À plus grande échelle, les mouvements internes du noyau terrestre y jouent également un rôle : des interactions complexes entre le noyau liquide et le manteau supérieur peuvent accélérer ou ralentir la rotation globale. Il arrive aussi que l’alignement Terre-Lune, selon sa position par rapport à l’équateur, ait une influence directe, comme cela semble avoir été le cas à l’été 2025.
Mais qu’est-ce qu’une milliseconde de moins dans une journée peut bien changer ? Si une telle différence est imperceptible dans la vie courante, elle a des conséquences très concrètes dans les domaines qui reposent sur une synchronisation extrême. Les horloges atomiques, qui fixent le Temps universel coordonné (UTC), doivent rester alignées avec la rotation réelle de la Terre. Les systèmes de géolocalisation comme le GPS, les télécommunications à haute fréquence ou l’astronomie de précision dépendent tous d’un repérage temporel rigoureux. Une désynchronisation, même infime, peut engendrer des erreurs de positionnement, des pertes de données ou des dysfonctionnements.
Ainsi, depuis 1972, compenser le ralentissement progressif de la rotation de la Terre a nécessité l’ajout de secondes intercalaires. Retirer une seconde, en revanche, serait une mesure inédite, qui devrait être appliquée si la Terre continue à tourner plus vite !
La rotation terrestre, que l’on imagine figée à 24 heures, est en réalité le fruit d’un équilibre dynamique et fragile. Les instruments modernes nous permettent aujourd’hui de détecter des écarts d’à peine une fraction de milliseconde, révélant des processus invisibles mais fondamentaux pour la stabilité de notre environnement technique.
Ces journées plus courtes rappellent que notre planète, bien qu’extrêmement stable et immuable en apparence, connaît des évolutions. Si les causes exactes de ces accélérations ne sont pas encore totalement comprises, elles offrent une occasion précieuse d’explorer l’intérieur de la Terre et les interactions qui gouvernent ses mouvements les plus subtils. C’est aussi une manière de mesurer à quel point la maîtrise du temps — aussi précise soit-elle — est soumise à des forces naturelles que nous ne contrôlons pas entièrement.
Temps du ciel, temps des hommes
Jusqu’ au 31 décembre 2025, l’exposition « Temps du ciel, temps des hommes » est en accès libre et gratuit tous les jours ouvrés de 9h à 18h au Centre de stockage de la Manche (CSM). Conçue par le le Groupe astronomique de Querqueville (GAQ), l’exposition dévoile comment l’Homme a su dompter, maîtriser et structurer le temps à travers les siècles.
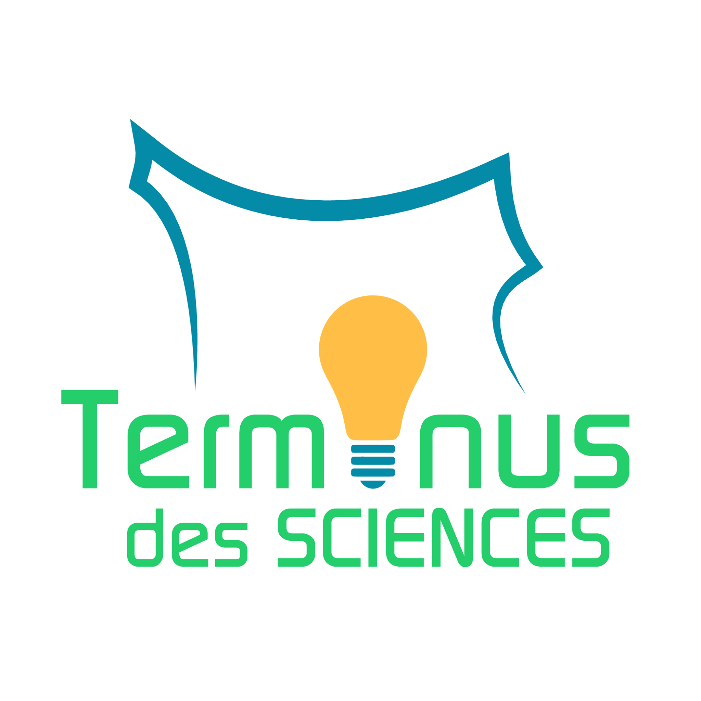
![You are currently viewing [Le 5 août 2025 : la journée la plus courte jamais mesurée sur Terre]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2025/08/astrolabe.jpg)