Chaque été, lorsque les nuits sont douces et que le ciel se dégage, des milliers de curieux scrutent l’obscurité à l’affût d’un éclair fugace. Ce spectacle, que l’on appelle les Perséides, n’est pas une simple curiosité du ciel : c’est la manifestation visible d’un processus astronomique régulier qui relie notre planète à une comète lointaine.
L’origine du phénomène remonte à la comète 109P/Swift-Tuttle, découverte en 1862 par deux astronomes américains. Cette comète suit une trajectoire elliptique autour du Soleil qui dure environ 133 ans. À chaque passage près de notre étoile, elle libère une traînée de poussières et de petits fragments, restes de matière cométaire. Ces débris se dispersent peu à peu dans l’espace, formant un immense nuage que l’orbite terrestre croise chaque année.
Entre la mi-juillet et la fin août, la Terre pénètre dans cette zone chargée de particules. À ce moment-là, ces minuscules grains de matière – parfois à peine plus gros qu’un grain de sable – pénètrent dans notre atmosphère à une vitesse fulgurante, de l’ordre de 60 kilomètres par seconde. Le frottement avec l’air les échauffe au point de les vaporiser complètement, tout en ionisant l’air autour d’eux. C’est cette émission lumineuse qui donne naissance à ce que nous appelons une étoile filante.
Le nom « Perséides » vient de l’endroit du ciel d’où semblent provenir ces météores. Par un effet de perspective, leurs trajectoires paraissent converger vers un point précis, situé dans la constellation de Persée. Ce point, que les astronomes nomment le radiant, n’est pas une source physique de lumière, mais un repère géométrique lié à notre position dans l’espace. En pratique, il n’est pas nécessaire de fixer Persée pour admirer le spectacle : les météores surgissent dans toutes les directions du ciel, si toutefois les conditions d’observations sont propices.
Si le moment le plus favorable pour l’observation se situe autour du 12 août, lorsque la Terre traverse la partie la plus dense du nuage de poussières, elles restent bien visibles pour plusieurs jours encore. Lors des meilleures années et dans un ciel parfaitement noir, il est possible de voir jusqu’à une centaine de météores par heure. Leur éclat est souvent intense et certains laissent derrière eux une traînée lumineuse persistante, visible quelques secondes. Les plus gros fragments peuvent produire des bolides, de véritables éclairs lumineux parfois teintés de vert ou de bleu selon leur composition chimique.
L’intérêt des Perséides dépasse la simple contemplation. Pour les astronomes, elles constituent une rare opportunité d’analyser la composition chimique des poussières cométaires grâce à la spectroscopie, et d’étudier la dynamique des essaims météoritiques. Leur suivi d’année en année permet de comprendre comment ces nuages de débris se dispersent sous l’effet de la gravité et de la lumière solaire.
Mais les Perséides ont aussi une place dans la culture et l’imaginaire. En Europe médiévale, elles étaient surnommées « larmes de Saint Laurent » car leur apparition coïncidait avec la fête du saint martyr, le 10 août. Dans de nombreuses traditions, voir une étoile filante est un signe de chance, une occasion de faire un vœu.
Observer les Perséides, c’est donc à la fois profiter d’un moment privilégié de l’été et assister à un phénomène astronomique qui relie notre planète à un corps céleste lointain. Allongé sous un ciel sombre, loin des lumières urbaines, on participe à un rituel immémorial : lever les yeux et regarder tomber les fragments d’une comète vieille de milliards d’années, brûlant dans l’atmosphère en un instant.
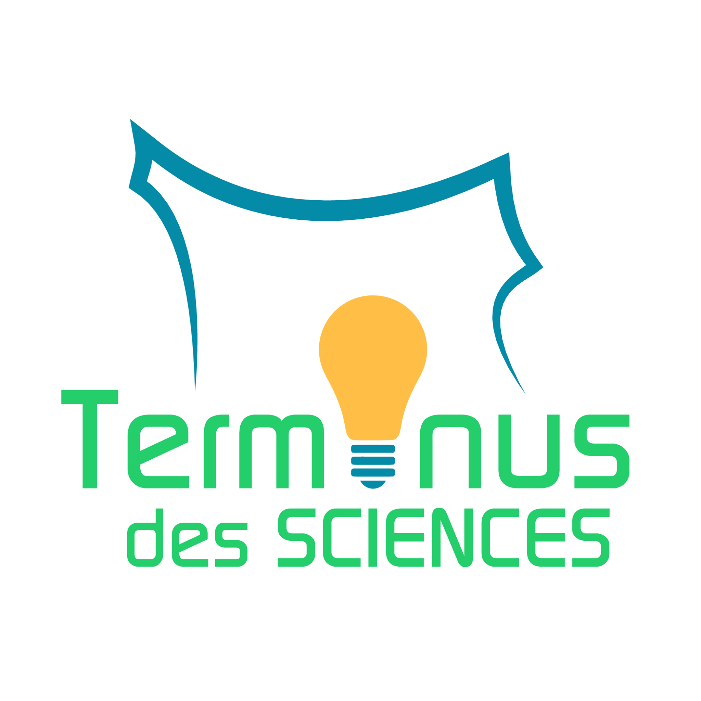
![You are currently viewing [Les Perséides : la pluie d’étoiles filantes d’août]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2025/08/perseides.jpg)