Les récentes intempéries qui ont frappé Mayotte rappellent à quel point les cyclones peuvent être destructeurs. Comment ces phénomènes naturels se forment-ils et dans quelle mesure le réchauffement climatique influence-t-il leur intensité ?
Les cyclones, aussi appelés ouragans ou typhons selon les régions du monde, sont des tempêtes tropicales de grande envergure. Ils se forment au-dessus des océans tropicaux chauds, où la température de l’eau dépasse généralement 26°C sur une profondeur d’au moins 50 mètres. Cette chaleur océanique est la source d’énergie qui alimente ces gigantesques systèmes météorologiques.
Le processus de formation d’un cyclone, appelé cyclogenèse, suit plusieurs étapes clés :
- Évaporation et ascension : Lorsque la surface de l’océan est chaude, l’eau s’évapore et monte dans l’atmosphère sous forme d’air chaud et humide.
- Refroidissement et condensation : À mesure que l’air s’élève, il se refroidit, provoquant la condensation de la vapeur d’eau en gouttelettes. Ce phénomène libère de la chaleur, appelée chaleur latente, qui réchauffe l’air environnant et le fait monter encore plus haut.
- Formation d’un système en rotation : Sous l’effet de la force de Coriolis (due à la rotation de la Terre), l’air en ascension commence à tourner autour d’un centre de basse pression. Cette rotation donne naissance à la structure caractéristique en spirale des cyclones.
- L’œil du cyclone : Au cœur du cyclone se trouve une zone de calme relative appelée « œil », entourée d’un mur nuageux dense où les vents sont les plus violents.
Pour qu’un cyclone continue de se renforcer, il a besoin d’un approvisionnement constant en chaleur et en humidité provenant de l’océan. Si ce flux est interrompu, par exemple lorsqu’un cyclone touche terre, il perd de sa force.
Le changement climatique provoqué par l’activité humaine entraîne une augmentation globale des températures. Cette hausse des températures a pour effets des océans plus chauds, une atmosphère plus humide ou encore une élévation du niveau de la mer.
Avec des températures océaniques plus élevées, les conditions sont plus favorables à la formation des cyclones et à leur intensification rapide. En effet, plusieurs études montrent que si la fréquence totale des cyclones ne semble pas changer de manière significative, le nombre de cyclones majeurs (catégories 3 à 5 sur l’échelle de Saffir-Simpson) a augmenté au cours des dernières décennies.
Aussi, l’air chaud retient davantage d’humidité. Avec une atmosphère plus chaude, les cyclones contiennent donc plus de vapeur d’eau, ce qui se traduit par des pluies plus intenses, augmentant les risques d’inondations et de glissements de terrain, comme l’ont montré les récents événements à Mayotte.
Enfin, l’élévation du niveau de la mer, en raison de la dilatation thermique des océans, aggrave les effets de la submersion marine rendant les inondations côtières plus importantes et plus destructrices.
Face à cette menace croissante, des mesures d’adaptation pour protéger les populations s’imposent. Cela inclut :
- Le développement de systèmes d’alerte précoce permettant aux habitants de se préparer à l’arrivée des cyclones.
- La construction d’infrastructures résistantes aux vents violents et aux inondations.
- La préservation des écosystèmes naturels, comme les mangroves, qui atténuent les effets des tempêtes en absorbant une partie de l’énergie des vagues.
Surtout, ces catastrophes soulignent, s’il le fallait encore, la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre que pour protéger les communautés vulnérables.
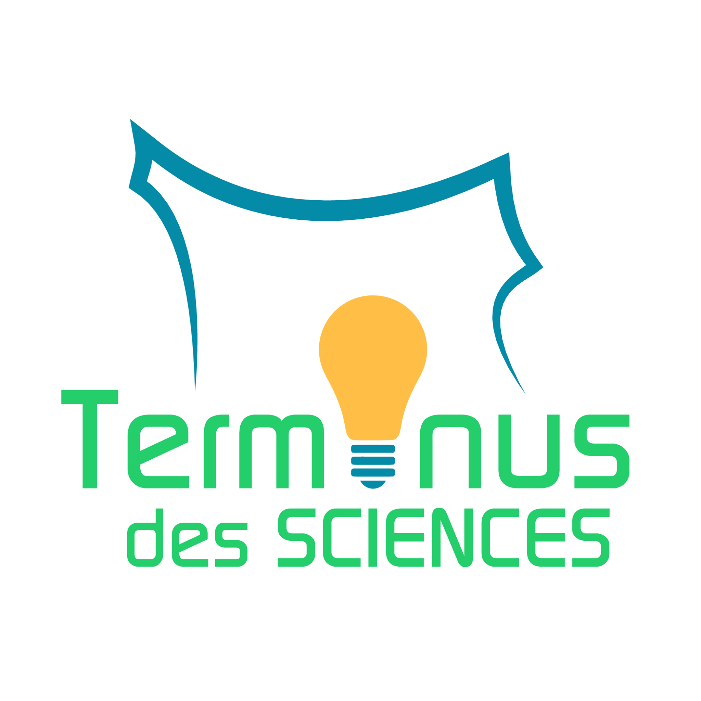
![You are currently viewing [Cyclones et réchauffement climatique : comprendre les mécanismes derrière les tempêtes]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2024/12/cyclone.jpg)