La récente loi Duplomb, adoptée en juillet 2025, a ravivé les tensions autour de l’usage de certains pesticides en agriculture, en particulier ceux que l’on regroupe sous le nom de neurocorticoïdes.
Ce terme fait référence à des insecticides neuroactifs, proches des néonicotinoïdes, longtemps utilisés pour protéger les cultures des insectes ravageurs. Leur efficacité est indéniable : en agissant sur le système nerveux des insectes, ils provoquent leur paralysie et leur mort. Pourtant, ces substances ont aussi un revers préoccupant, car elles affectent bien plus que les seuls nuisibles visés.
Le cœur du problème réside dans leur mode d’action et leur persistance. Les neurocorticoïdes, une fois appliqués, sont absorbés par la plante et se retrouvent dans toutes ses parties : feuilles, tiges, fleurs, mais aussi nectar et pollen. Cette propriété les rend redoutablement efficaces, mais elle expose aussi tous les insectes qui interagissent avec la plante, y compris les pollinisateurs comme les abeilles. Or, ces derniers sont essentiels à la reproduction de nombreuses espèces végétales et, par extension, au bon fonctionnement des écosystèmes agricoles.
De nombreuses études ont mis en évidence les effets délétères de ces molécules sur les abeilles : désorientation, troubles de la mémoire, diminution de la fertilité, voire mortalité directe. Ces effets, même à faibles doses, sont susceptibles d’entraîner un affaiblissement des colonies, compromettant leur survie. À cela s’ajoute une toxicité environnementale plus large, puisque ces produits, très persistants dans les sols, peuvent affecter la microfaune, les vers de terre, les insectes auxiliaires et même les oiseaux insectivores.
Face à ces constats, la France avait interdit l’usage de la plupart des néonicotinoïdes en 2018. Mais certains agriculteurs, notamment dans les filières betteravières et fruitières, ont plaidé pour leur retour, mettant en avant l’absence d’alternatives réellement efficaces pour lutter contre des ravageurs spécifiques. C’est dans ce contexte que la loi Duplomb permet, à titre exceptionnel, l’utilisation encadrée de deux neurocorticoïdes : l’acétamipride et le flupyradifurone.
Ce retour est strictement encadré. Seules certaines cultures sont concernées, sur une surface limitée. Chaque année, un décret devra confirmer ou non la poursuite de ces autorisations, en s’appuyant sur des rapports scientifiques établis par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES). Ce mécanisme vise à garantir une réévaluation régulière des risques, dans une logique de transition plutôt que de retour en arrière durable.
La controverse reste vive. Les associations environnementales dénoncent un recul dans la protection de la biodiversité et regrettent que la France s’éloigne de ses engagements en matière d’agroécologie. Elles soulignent qu’il existe des pistes alternatives, certes plus complexes à mettre en œuvre, mais potentiellement plus durables. La rotation des cultures, l’introduction d’insectes auxiliaires, le développement de variétés plus résistantes ou l’usage de produits biocontrôles sont autant de leviers possibles, encore sous-exploités.
En définitive, la loi Duplomb illustre bien la difficulté d’articuler urgence économique et exigence écologique. Elle pose une question essentielle : comment soutenir les agriculteurs sans compromettre la santé des écosystèmes dont dépend notre sécurité alimentaire. La réponse ne pourra être trouvée que dans un effort collectif, associant chercheurs, agriculteurs, pouvoirs publics et citoyens, pour bâtir une agriculture moins dépendante de la chimie et plus résiliente face aux défis environnementaux.
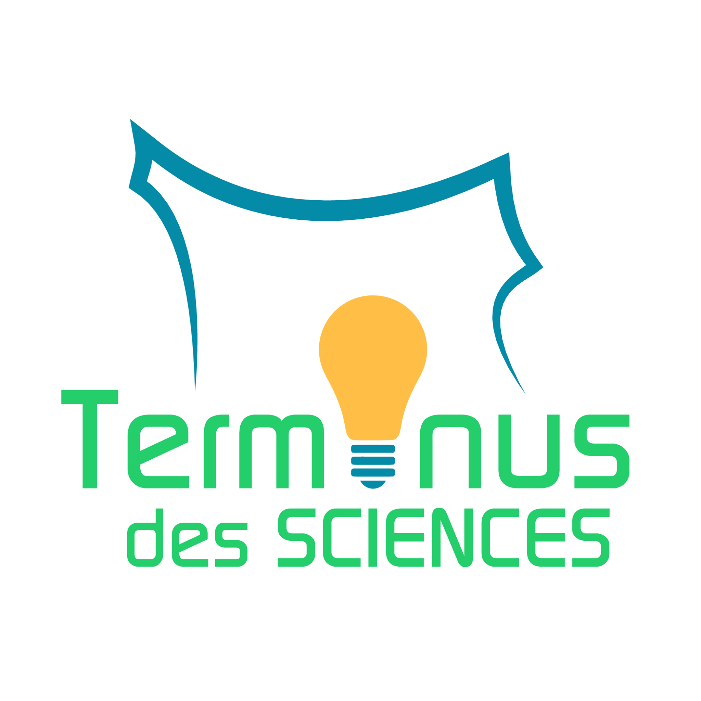
![You are currently viewing [Neurocorticoïdes, agriculture et biodiversité : comprendre les enjeux de la loi Duplomb]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2025/08/betteraves.jpg)