L’heure où les outils de la recherche autorisent une approche toujours plus intime du vivant, notamment par l’imagerie dont le changement d’échelle est à l’origine d’une collecte de données si importante sur l’objet observé que l’on ne saurait les modéliser ou leur donner du sens sans le secours de l’intelligence artificielle, on peut découvrir ou redécouvrir, à l’occasion du 130e anniversaire de sa naissance, un des pionniers de la biologie dont les travaux jalonnent le long chemin qui mène aux grandes découvertes d’aujourd’hui.
Deuxième fils d’Edmond Rostand, l’auteur de Cyrano de Bergerac et de Rosemonde Girard, poétesse, Jean Rostand naît à Paris le 30 octobre 1894. Le futur biologiste passe son enfance à Cambo-les-Bains, au Pays basque, où son père choisit de s’installer après y avoir passé sa convalescence à la suite d’une affection pulmonaire. Cette heureuse disposition sera déterminante pour le futur biologiste qui dispose là d’un terrain favorable pour y étudier les insectes avec l’œil du chercheur solitaire qu’il sera sa vie durant. À neuf ans, Jean Rostand découvre l’œuvre de l’entomologiste Jean-Henri Fabre avec qui il correspond. Le très jeune garçon recevra de son mentor des scarabées sacrés. Sa vocation est née, il sera naturaliste. Bachelier, Jean Rostand entre à la Sorbonne en 1913. Mais sa filiation avec le célèbre dramaturge et son tempérament solitaire le desservent auprès de ses pairs dont il ressent durement la méfiance. À l’obtention de ses licences, le futur académicien poursuivra donc, seul, ses recherches à l’exemple de son maître à penser, Jean-Henri Fabre. Vient la guerre. Réformé pour sa chétive constitution, Jean Rostand rejoint l’hôpital du Val de Grâce où il participera à la fabrication de vaccins anti-typhiques.
En 1922, Jean Rostand s’installe à Ville-d’Avray dans une villa où il aménage un laboratoire pour y mener ses recherches en biologie génétique. Son matériel d’étude comprend surtout les batraciens, grenouilles et crapauds dont le mode de reproduction se prête à ses travaux sur l’embryologie. Il en fera venir chez lui jusqu’à quarante mille pour les examiner systématique ment à la recherche de mutations génétiques ou héréditaires. C’est en expérimentant la parthénogenèse sur les amphibiens (reproduction sans mâle), qu’il découvrira l’influence des basses températures sur les œufs. Le chercheur solitaire découvrira également l’action de la glycérine sur les tissus vivants destinée à la congélation. Cette découverte sera notamment à l’origine des banques de spermes.
Attentif aux travaux de ses pairs, Jean Rostand reconnaît très tôt l’intérêt des travaux du généticien américain Thomas Morgan sur les chromosomes qu’il s’emploiera à faire connaître; ce sera son premier ouvrage de vulgarisation: Les chromosomes artisans, de l’hérédité et du sexe (Hachette – 1928). Déterministe convaincu, Rostand dira plus tard que l’homme est déterminé par son patrimoine héréditaire et l’influence de son milieu y compris prénatal. Pour lui, la conscience entre pour peu dans les décisions que nous prenons.
Le chercheur infatigable qu’il était s’appliqua toujours à mettre à la portée du grand public des notions complexes telles que l’hérédité, la génétique, la tératologie ou la parthénogenèse. Biologiste soucieux d’éthique, le solitaire de Ville-d’Avray alerta très tôt sur les dangers des manipulations génétiques et des tentations qu’elles contiennent en mettant le patrimoine héréditaire de l’homme à portée d’éprouvette. Nul doute que son regard sur la science d’aujourd’hui eut été bienveillant. Jean Rostand était un humaniste avant tout; il plaçait la recherche très haut en ce qu’elle sert l’Homme dans sa diversité génétique et sociale. On ne saurait évoquer Jean Rostand sans parler de ses satires sociales qui, de sa part, étaient l’émanation d’un esprit tourné vers l’Homme en tant qu’être perfectible dont les travers traduisent plus un manque de maturité qu’un défaut véritable.
L’abondance et la qualité de ses œuvres littéraires, tant scientifiques que philosophiques ou moralistes, motiveront son élection à l’Académie française en 1959 dans le fauteuil n° 8 qu’occupa Pierre-Simon marquis de Laplace de 1816 à 1827. Jean Rostand disparaît en 1977 en laissant nombre de voies de recherches et la lanterne des connaissances fondamentales qu’il contribua à allumer pour les explorer.
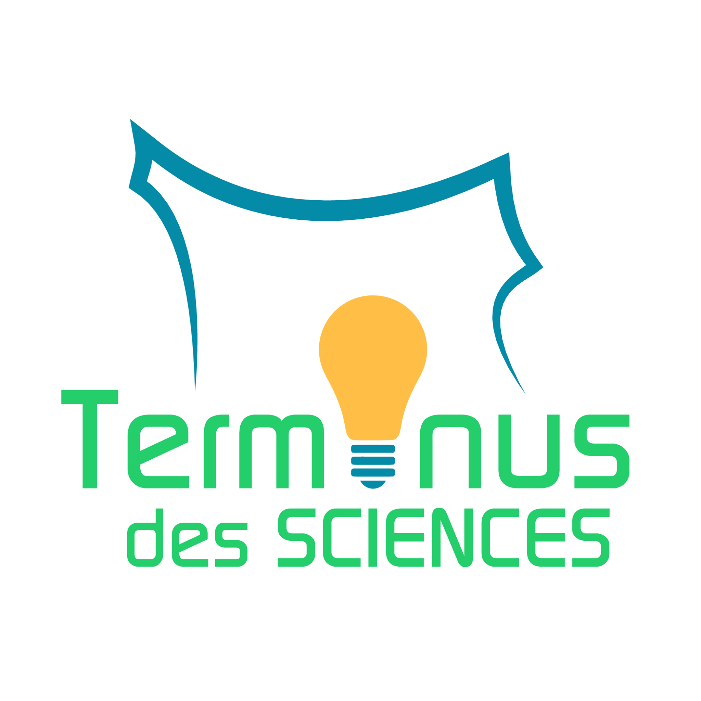
![You are currently viewing [Jean Rostand, l’homme aux grenouilles]](https://terminusdessciences.fr/wp-content/uploads/2024/12/rostand.jpg)