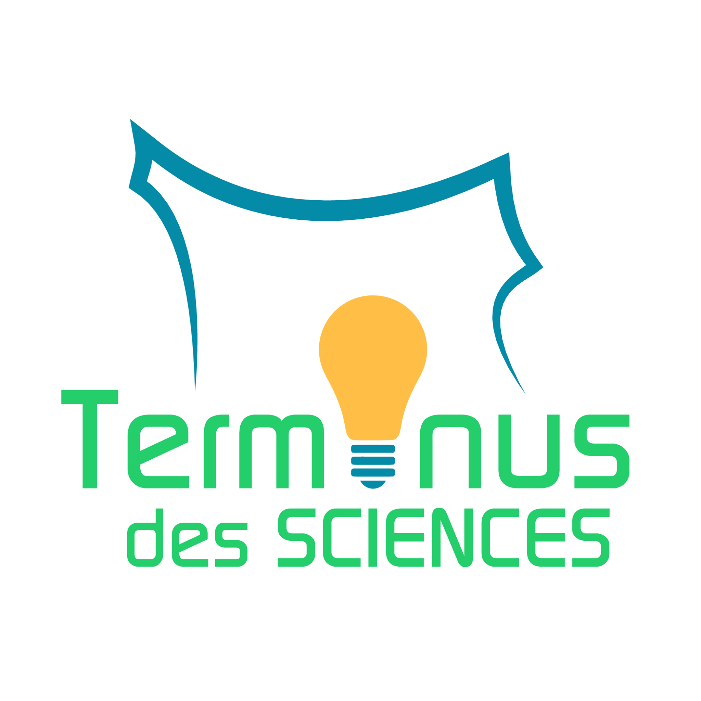Terminus des Sciences avait organisé en 2023 des randonnées géologiques pour découvrir la géologie locale lors de balades dans le Cotentin, accompagnées d’un médiateur spécialisé. Cette expérience ayant été appréciée, nous avons décidé de réitérer cette activité avec une médiatrice spécialiste de la biologie marine pour découvrir la faune et la flore du bord de mer !

Découverte et étude du plancton
Le plancton désigne l’ensemble des organismes, généralement microscopiques, qui dérivent au gré des courants dans les eaux marines et douces. Il est constitué de deux grandes catégories :
- Le phytoplancton, constitué d’organismes végétaux microscopiques, qui effectuent la photosynthèse.
- Le zooplancton, regroupant de petits animaux (comme les larves de poissons, les copépodes ou les méduses).
Bien qu’invisible à l’œil nu, le plancton est fondamental pour les écosystèmes aquatiques. Il forme la base de la chaîne alimentaire et joue un rôle majeur dans la régulation du climat, notamment par l’absorption du dioxyde de carbone atmosphérique.
Le littoral du Cotentin est un lieu privilégié pour l’étude du plancton, du fait de :
- courants côtiers puissants, notamment liés aux marées, qui favorisent le brassage des eaux et donc la prolifération planctonique.
- apports nutritifs naturels issus des rivières, des vasières et des herbiers marins, qui enrichissent l’eau en sels minéraux nécessaires au développement du phytoplancton.
- une diversité d’habitats côtiers (baies, estuaires, zones rocheuses) qui offrent des niches écologiques variées pour différentes espèces planctoniques.
L’étude du plancton commence véritablement au XIXe siècle, avec l’invention du filet à plancton par le biologiste Victor Hensen. Ces filets très fins permettent de capturer ces organismes minuscules pour les observer au microscope.
Sur le littoral normand, la tradition des stations marines (comme celle de Luc-sur-Mer ou de Granville) a permis le développement de programmes d’observation côtière.
L’analyse du plancton a considérablement évolué grâce à :
- La microscopie électronique, qui permet d’observer les détails cellulaires.
- La cytométrie en flux, qui trie et compte automatiquement les cellules.
- Le séquençage ADN, qui identifie les espèces à partir de leur code génétique.
- Les satellites et capteurs océanographiques, qui suivent la répartition du phytoplancton à grande échelle.
Ces outils permettent de comprendre les dynamiques saisonnières, les impacts du réchauffement climatique ou encore les risques de proliférations algales toxiques.
Le plancton est aussi un indicateur de la santé des océans. Par exemple, une diminution du phytoplancton peut signaler une eutrophisation ou un changement dans les courants marins. Le zooplancton, quant à lui, est sensible à la pollution chimique ou thermique.
Dans le Cotentin, plusieurs programmes (souvent portés par des associations locales et des chercheurs) surveillent la composition du plancton pour anticiper les déséquilibres écologiques, grâce à des campagnes de collecte et des actions de science participative. Depuis une dizaine d’années, des initiatives locales comme les sorties en mer éducatives, les aquariums pédagogiques ou les laboratoires itinérants permettent au grand public de découvrir l’univers du plancton. Ces actions permettent de faire découvrir que la mer est vivante, jusque dans ses plus petits habitants.
Découverte et étude du plancton, digue de Collignon :
Découverte des espèces en pêche à pied
La pêche à pied consiste à récolter, à marée basse, les espèces marines accessibles à pied sur l’estran : coquillages, crustacés, algues, et parfois petits poissons. Cette pratique est à la fois traditionnelle, familiale et scientifiquement précieuse : elle met en contact direct les promeneurs avec la biodiversité marine.
Le littoral du Cotentin, modelé par les marées les plus fortes d’Europe, abrite une grande diversité de milieux : vasières, rochers, herbiers, zones sableuses… Autant d’habitats pour une faune et une flore extrêmement variées.
Parmi les espèces emblématiques observables lors de pêches à pied, on trouve :
- Coquillages : palourdes, coques, moules, huîtres sauvages, ormeaux (réglementés).
- Crustacés : crevettes grises, crabes verts, étrilles, parfois araignées de mer.
- Échinodermes : étoiles de mer, oursins, holothuries.
- Poissons : gobies, blennies, parfois juvéniles de bars ou de soles dans les flaques.
- Algues : laitue de mer, fucus, haricots de mer, souvent utilisées en cuisine ou cosmétique.
La pêche à pied est aussi une source d’observation et de découverte scientifique. Elle permet d’inventorier la biodiversité locale, d’identifier des espèces rares ou envahissantes ou encore de suivre l’évolution des populations liées aux changements environnementaux.
Dans le Cotentin, des naturalistes, biologistes marins et associations locales réalisent des suivis d’espèces sur les estrans rocheux. Des programmes participatifs, comme le réseau Littorea ou le programme Biolit, invitent le public à contribuer à cette veille écologique. Parce que les estrans sont fragiles et exploités par de nombreux pêcheurs, une réglementation encadre strictement la pêche à pied. Des panneaux pédagogiques sont souvent installés à l’entrée des plages du Cotentin pour rappeler ces règles et sensibiliser aux bons gestes : reboucher les trous, remettre les pierres en place, ne pas cueillir les espèces protégées.
De nombreuses structures locales (syndicats mixtes du littoral, parcs naturels marins, associations) organisent des sorties encadrées de pêche à pied. Ces animations permettent de faire découvrir les espèces dans leur milieu naturel, expliquer les enjeux de préservation ou montrer l’impact potentiel d’une pêche non respectueuse.
Ces sorties sont souvent l’occasion, pour les familles, les scolaires ou les touristes, de vivre un moment ludique et enrichissant tout en découvrant la richesse écologique du littoral. Enfin, la pêche à pied joue un rôle clé dans le développement d’une conscience environnementale locale. En découvrant les organismes vivants, en les manipulant avec précaution et en observant leurs comportements, petits et grands prennent conscience que la mer est un milieu complexe, riche et vulnérable.
Découverte des espèces en pêche à pied, digue de Collignon :
Etude des dunes
Les dunes côtières sont des formations naturelles dynamiques, créées par l’accumulation de sable transporté par le vent depuis les plages. Ce sable est piégé par des éléments stabilisateurs comme la végétation ou les reliefs. On distingue plusieurs types de dunes selon leur position et leur degré de fixation :
- Les dunes blanches, proches de la plage, mobiles et peu végétalisées.
- Les dunes grises, plus en retrait, colonisées par une végétation herbacée plus dense.
- Les dunes fossiles, anciennes et parfois boisées, plus stables.
Ces milieux participent à la protection du littoral en formant un rempart naturel contre l’érosion, les tempêtes et les submersions marines, mais ils abritent aussi une biodiversité spécifique et fragile, qui dépend des conditions extrêmes de vent, de sel et de sécheresse.
Située à l’ouest du département de la Manche, la dune de Biville s’étend sur plus de 6 km entre Vauville et Siouville. Il s’agit de l’un des plus grands complexes dunaires de Normandie. Ce site remarquable combine une dynamique naturelle encore active et une mosaïque d’habitats, allant des dunes vives aux landes sèches, en passant par des pannes humides riches en amphibiens.
La faune et la flore y sont particulièrement variées, avec notamment :
- L’oyat, espèce pionnière indispensable à la fixation du sable.
- Des orchidées dunaires, rares et sensibles au piétinement.
- Des oiseaux nicheurs, comme le gravelot à collier interrompu ou la linotte mélodieuse.
- Des insectes et reptiles adaptés aux conditions extrêmes de ce milieu.
Ce site est classé Natura 2000, protégé par le Conservatoire du littoral et géré en partenariat avec des acteurs locaux. Les dunes sont ainsi au cœur de projets de résilience côtière, qui visent à laisser plus d’espace au vivant pour s’adapter, plutôt que de lutter systématiquement contre l’érosion par des enrochements ou digues.
La gestion des dunes comme celle de Biville repose sur plusieurs principes fondamentaux :
1. Préserver la dynamique naturelle en évitant les plantations excessives, les aménagements lourds ou les clôtures. À Biville, une grande partie du massif est laissée en évolution libre, sauf dans les zones de pression touristique.
2. Encadrer les usages humains en évitant le piétinement excessif, les passages de véhicules ou les dépôts sauvages qui détériorent rapidement la végétation dunaire. Des sentiers balisés, des panneaux de sensibilisation et des actions d’écogarde permettent de canaliser les usages.
3. Valoriser les pratiques agroécologiques par des partenariats avec des éleveurs pour entretenir les milieux ouverts par le pâturage extensif. Cette gestion douce limite la fermeture des milieux et favorise une diversité floristique.
4. Suivre l’évolution du milieu pour mesurer l’évolution de la végétation, le recul du trait de côte, ou encore l’impact du changement climatique. La dune de Biville est ainsi un observatoire du vivant et du climat à ciel ouvert.
Etude des dunes, dunes de Biville :
Laisse de mer et sensibilisation aux enjeux des déchets sur la plage
La laisse de mer désigne l’ensemble des matériaux naturels déposés par la mer à marée haute. Elle forme une bande plus ou moins continue sur la plage, composée de :
- Débris organiques : algues, bois flotté, coquillages, restes d’animaux marins.
- Éléments minéraux : galets, sable, débris rocheux.
- Parfois, malheureusement, des déchets d’origine humaine : plastiques, filets, mégots, etc.
La laisse de mer est souvent perçue comme une nuisance visuelle, mais elle joue un rôle écologique fondamental. Elle constitue en effet un micro-écosystème riche et fragile, siège de nombreuses fonctions écologiques :
- Nourriture : pour les oiseaux limicoles (bécasseaux, gravelots), les insectes et crustacés du rivage.
- Habitat : pour des espèces comme les coléoptères du sable ou les puces de mer (talitres).
- Protection : elle contribue à la formation et à la fixation des dunes en retenant le sable transporté par le vent.
En se décomposant, elle enrichit aussi le sable en matière organique, participant à la fertilité naturelle du littoral. Malheureusement, la laisse de mer est aussi le réceptacle des déchets marins, issus de diverses origines :
- Activités de pêche (cordages, filets, casiers).
- Rejets domestiques (emballages plastiques, cotons-tiges, bouteilles).
- Pollutions fluviales (déchets transportés par les rivières jusqu’à la mer).
- Activités touristiques (déchets laissés sur la plage).
Ces déchets perturbent les écosystèmes, blessent ou tuent la faune (par ingestion ou enchevêtrement) et peuvent dégrader durablement les paysages côtiers. Beaucoup de collectivités pratiquent des ramassages mécaniques réguliers des laisses de mer, notamment en haute saison touristique. Si cela permet de nettoyer les plages des déchets visibles, cela a aussi des effets négatifs comme la destruction du micro-habitat de la laisse naturelle, le compactage du sable par les engins ou l’érosion accrue en l’absence de matière organique pour fixer le sable.
Aujourd’hui, une nouvelle approche se développe : le nettoyage sélectif et raisonné, qui vise à préserver la laisse naturelle tout en éliminant les déchets anthropiques.
La gestion durable de la laisse de mer passe par la sensibilisation du public :
- Comprendre son rôle écologique : des panneaux explicatifs sur les plages aident à changer le regard sur ces “algues” ou “débris” souvent jugés sales.
- Participer à des collectes citoyennes : des opérations comme les Initiatives Océanes, les journées “Nettoyons la nature” ou les actions des CPIE mobilisent des bénévoles pour ramasser les déchets tout en apprenant à les identifier.
- Modifier nos comportements : en réduisant les déchets à la source, en utilisant moins de plastique, et en respectant les règles de tri, chacun peut limiter l’apport de déchets vers la mer.
Sur les côtes du Cotentin comme ailleurs, préserver la laisse de mer et limiter les déchets marins suppose une coordination entre collectivités, citoyens, associations, pêcheurs et touristes. C’est une démarche à la fois écologique, éducative et citoyenne, qui participe à la santé des océans.
Laisse de mer et sensibilisation aux enjeux des déchets sur la plage, plage d’Urville-Nacqueville :
Toutes les sorties Coquillages et crusta’sciences ici
N’hésitez pas à vous inscrire ou à partager ces liens:
- Samedi 26/04, de 09h à 12h, digue de Collignon : découverte et étude du plancton
- Samedi 26/04, de 14h à 17h, plage de Collignon : découverte des espèces en pêche à pied
- Dimanche 27/04, de 09h à 12h, digue de Collignon : découverte et étude du plancton
- Dimanche 27/04, de 14h30 à 17h30, plage de Collignon : découverte des espèces en pêche à pied
- Vendredi 02/05, de 9h30 à 12h30, dunes de Biville : étude des dunes
- Vendredi 02/05, de 14h à 17h, plage d’Urville-Nacqueville : laisse de mer et sensibilisation aux enjeux des déchets sur la plage
- Samedi 03/05, de 09h30 à 12h30, plage d’Urville-Nacqueville : laisse de mer et sensibilisation aux enjeux des déchets sur la plage
- Samedi 03/05, de 14h à 17h, dunes de Biville : étude des dunes
- Dimanche 04/05, de 9h30 à 12h30, dunes de Biville : étude des dunes
- Dimanche 04/05, de 14h à 17h, plage d’Urville-Nacqueville : laisse de mer et sensibilisation aux enjeux des déchets sur la plage